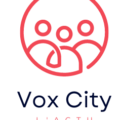Cette semaine, une coalition de seize associations et syndicats, incluant des noms éminents tels que le Secours Catholique et la CGT, a pris la décision audacieuse d’attaquer le gouvernement français en justice. Leur grief ? Un décret mis en vigueur le 1er juin, qui durcit notablement les sanctions imposées aux demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) en cas de manquement à leurs engagements contractuels.
Origine et répercussions du décret
Ce décret controversé est une conséquence directe de la Loi pour le plein emploi, votée le 18 décembre 2023, qui a instauré l’automatisation de l’inscription à France Travail pour toutes les personnes sans emploi. Parmi les nouvelles mesures, l’accent est mis sur un renforcement des obligations contractuelles pour les bénéficiaires du RSA. Ces derniers, ainsi que leurs conjoints, les jeunes suivis par des missions locales, et les personnes en situation de handicap, se voient inscrits de façon systématique sur les listes de l’opérateur public pour l’emploi, France Travail.
La signature d’un contrat d’engagement implique désormais pour les bénéficiaires de s’engager dans 15 heures d’activités hebdomadaires visant à leur réinsertion professionnelle. En cas de non-respect de cet engagement, le décret prescrit une nouvelle échelle de sanctions, flexible mais sévère, qui introduit la notion de « sanction-remobilisation ».
La nature des sanctions
Auparavant, un manquement, tel qu’un rendez-vous manqué, se traduisait systématiquement par une radiation. Désormais, avec le décret du 30 mai, des suspensions d’allocations pouvant aller de 30 à 100% et d’une durée d’un à deux mois peuvent être immédiatement exécutées pour un premier manquement. Un deuxième manquement expose le bénéficiaire à une suspension pouvant durer jusqu’à quatre mois. En cas de suspension totale durant quatre mois consécutifs, l’individu est radié pour la même durée. Toutes ces mesures peuvent être réversibles si la personne concernée satisfait ses engagements avant la fin de la sanction.
Des réactions mitigées
La ministre du Travail de l’époque, Catherine Vautrin, avait justifié ce nouveau barème en le présentant comme un « équilibre entre droits et devoirs », visant à créer les conditions propices à un retour durable à l’emploi. Toutefois, cette vision est loin de faire l’unanimité parmi les organisations de lutte contre la précarité.
Ces dernières estiment que le décret franchit une « ligne rouge », comme l’ont exprimé collectivement dans une tribune publiée dans le journal Libération. Elles dénoncent des sanctions jugées « brutales » et incompatibles avec le respect des droits fondamentaux, notamment le droit à une existence décente, un principe inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946. L’un des principaux points de discorde concerne l’apparente intransigeance qui impose aux allocataires d’accepter des contrats d’engagement potentiellement inadaptés à leur situation, sous peine de perdre leur revenu de base.
Un délai de contestation controversé
Un autre point épineux concerne le délai accordé aux allocataires pour contester une sanction. Ils disposent de dix jours pour faire appel, un laps de temps qualifié de « dérisoire » par le collectif d’associations, surtout pour ceux qui doivent trouver l’appui d’une association pour les aider dans leur démarche.
Conséquences sur les plus vulnérables
Les associations soulignent par ailleurs que les exigences d’activité hebdomadaire ne tiennent pas suffisamment compte des situations particulières telles que celles des mères isolées, des individus souffrant de handicap, ou encore des aidants familiaux. La bureaucratisation du processus de suivi, souvent perçue comme une démarche de contrôle plus qu’un soutien, aggrave les défis quotidiens déjà confrontés par les allocataires du RSA.
Pour certains travailleurs sociaux, le passage du temps à contrôler et sanctionner au détriment d’un réel accompagnement est symptomatique d’une détérioration du sens même de leur mission, conduisant inexorablement à un épuisement professionnel.
Une évaluation attendue mais difficile
Le ministère du Travail persiste à affirmer que le nouveau système de « suspension-remobilisation » permet un accompagnement continu, puisque les bénéficiaires peuvent récupérer leurs aides s’ils s’acquittent des actions de remobilisation prescrites. Pourtant, le mois d’avril dernier a déjà livré quelques enseignements lors de l’expérimentation de ces mesures dans huit régions, où il a été noté qu’il n’y a pas eu de hausse marquée des taux de sanctions.
En conclusion, la question centrale reste de savoir si ces nouvelles règles, qui se veulent incitatives et éducatives, pourront effectivement remplir leur mission sans aliéner ceux qu’elles prétendent aider. Malgré la bonne intention affichée par l’État de garantir un accompagnement individualisé, la mise en pratique effective des nouvelles mesures suscite de nombreuses interrogations tant parmi les intéressés que les experts du secteur social.