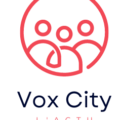Une loi révolutionnaire mais des défis persistants
En 1965, une étape significative a été franchie pour l’émancipation des femmes en France. La loi du 13 juillet de cette année a permis aux épouses de travailler sans le consentement de leur conjoint, de disposer librement de leur salaire une fois les charges du mariage acquittées, et d’ouvrir un compte bancaire à leur nom. Cette avancée, adoptée sous la présidence de Charles de Gaulle, représentait un tournant majeur dans la lutte pour l’égalité des droits entre hommes et femmes.
Cependant, malgré ces progrès juridiques, l’indépendance financière des femmes reste un sujet complexe. Un sondage récent révèle que les inégalités entre les hommes et les femmes persistent toujours, notamment sur les plans patrimonial et salarial.
Des inégalités encore prononcées
Le sondage mené par La France Mutualiste et Bpifrance Le Lab met en lumière la situation préoccupante des femmes face à l’investissement financier. Les résultats montrent que les femmes sont moins enclines à investir dans des produits financiers diversifiés que leurs homologues masculins. Par exemple, seulement 31% des femmes interrogées déclarent posséder une assurance-vie, contre 38% des hommes. La situation est encore plus préoccupante pour d’autres produits financiers tels que les plans d’épargne en actions (PEA) ou les comptes-titres, où la participation féminine est nettement inférieure.
Ce fossé peut s’expliquer par plusieurs facteurs, dont le manque de moyens financiers. En effet, plus de trois femmes sur quatre déclarent ne pas être en mesure de placer leur argent faute de revenus suffisants. Ce chiffre est à comparer avec 60% chez les hommes, soulignant une disparité flagrante dans la capacité d’investissement.
Prudence ou manque de ressources ?
Lorsque les femmes peuvent épargner, elles privilégient souvent des placements sûrs comme les livrets réglementés, notamment le livret A et le livret de développement durable et solidaire (LDDS). Cette prudence est souvent attribuée à un manque de ressources, mais elle reflète aussi une aversion au risque plus marquée que chez les hommes. En effet, seules 16% des femmes choisissent des placements risqués à haut rendement, contre 26% des hommes.
Cette différence, qui semble anecdotique, a des répercussions importantes sur la sécurité financière à long terme des femmes. Les écarts dans les choix de placements conduisent à des différences d’accumulation patrimoniale, renforçant ainsi l’insécurité financière des femmes à l’approche de l’âge de la retraite.
Le fossé des rémunérations
Les disparités salariales entre les sexes restent également une préoccupante réalité. En 2023, le salaire moyen des femmes dans le secteur privé était de 21 340 euros par an, soit 22,2% de moins que celui des hommes, selon une étude de l’Insee. Même en neutralisant les différences de volume de travail, l’écart de salaire en équivalent temps plein reste significatif, atteignant 14,2%.
Malgré l’existence depuis 1972 d’une loi exigeant l’égalité de rémunération pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, les femmes continuent de percevoir des salaires inférieurs. Cette inégalité salariale est un obstacle majeur à l’indépendance financière totale des femmes.
Vers une égalité financière ?
Bien que des progrès significatifs aient été réalisés en termes de droits des femmes au travail, l’égalité financière reste un objectif à atteindre. Des initiatives et politiques publiques doivent être renforcées pour réduire ces écarts persistants. Sensibilisation, formation financière et accès à des opportunités d’investissement doivent être au cœur des stratégies pour améliorer l’égalité économique entre hommes et femmes.
L’Histoire a démontré que les lois peuvent initier des changements, mais leur impact dépend largement de la mise en œuvre concrète et de l’évolution des mentalités. L’indépendance financière des femmes reste une bataille à mener, tant sur le front économique que social, pour assurer une égalité véritablement durable.