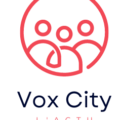La montée des tensions internationales a remis en lumière l’importance de renforcer les forces armées. Dans ce contexte, le rôle des réservistes se révèle crucial. Mais qu’implique réellement le fait de devenir réserviste dans l’armée française ?
Le contexte actuel et l’appel à l’engagement
Le président de la République a récemment appelé les citoyens à s’engager davantage dans le contexte des bouleversements internationaux. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a souligné le besoin d’accélérer l’armement tout en écartant l’idée de rétablir un service militaire obligatoire. En revanche, il insiste sur l’importance d’augmenter le nombre de réservistes, essentiels au soutien militaire.
Qui sont les réservistes ?
Contrairement aux militaires de carrière, les réservistes poursuivent généralement une activité professionnelle parallèle. Ils sont fondamentaux pour des missions de soutien et d’appoint. On les classe en deux principales catégories :
- La réserve opérationnelle : Composée de volontaires, elle apporte un appui direct aux unités sur le terrain.
- La réserve citoyenne de défense et de sécurité (RCDS) : Rassemblant des civils volontaires, cette réserve mobilise principalement des experts dans des domaines spécifiques, tels que la cybersécurité.
Conditions pour devenir réserviste
L’engagement en tant que réserviste requiert la satisfaction de certaines conditions essentielles :
- Être de nationalité française.
- Avoir un âge compris entre 17 et 72 ans.
- Avoir participé à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) ou avoir effectué le service national.
- Avoir un casier judiciaire vierge.
- Être médicalement apte.
Les démarches pour rejoindre la réserve varient selon le corps de l’armée de prévoir – Terre, Air, Marine ou Gendarmerie – et sont principalement effectuées en ligne via le portail officiel.
Rémunération et avantages
La rémunération des réservistes dépend de leur grade et de leur ancienneté. Les contrats au sein de la réserve opérationnelle varient de 1 à 5 ans et prévoient une rémunération comprise entre 40 et 200 euros par jour, hors fiscalité. En plus de cela, les réservistes reçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement.
Après une formation initiale de 12 jours, ils peuvent être appelés à intervenir jusqu’à 60 jours par an, ce chiffre pouvant être porté à 210 jours selon les besoins. Quant à la RCDS, elle regroupe des bénévoles civils, sans rémunération, qui prêtent leurs compétences dans des moments critiques.
Protection et soutien
En plus des avantages précités, les réservistes bénéficient de l’autorisation à des jours d’absence dans leur emploi principal pour se consacrer à leur engagement militaire : jusqu’à 10 jours, voire 5 pour les salariés de PME. En cas d’accident ou de blessure pendant leur service, la prise en charge médicale est assurée par l’État, y compris le suivi psychologique et le soutien familial.
Devenir réserviste, c’est non seulement offrir son potentiel civique au profit de la défense nationale, mais aussi enrichir son parcours personnel par une expérience valorisante et formatrice.